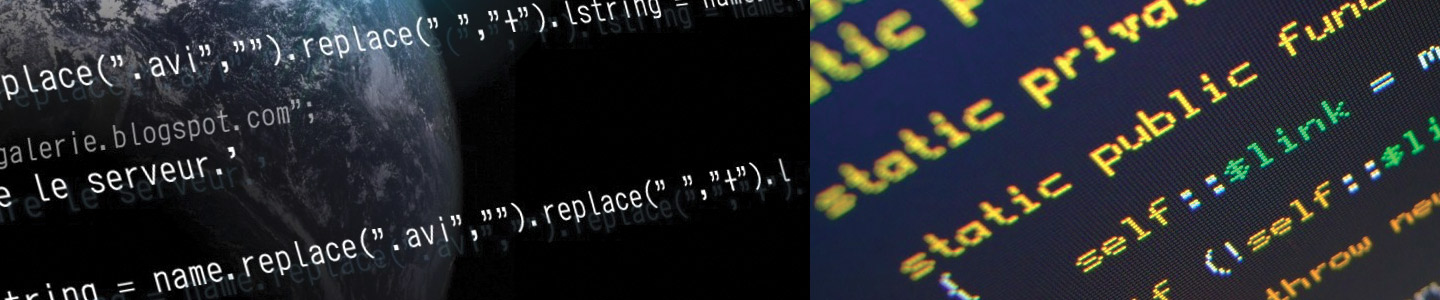Ce contenu est réservé aux membres du site. Si vous êtes un utilisateur existant, veuillez vous connecter. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire ci-dessous.
Les méthodes AGILES
Cours sur les Méthodes Agiles Introduction : Pourquoi l’Agilité ? Dans un monde incertain et changeant, surtout dans les domaines innovants comme la science des données ou l’IA et même l’informatique en général, les méthodes traditionnelles de gestion de projet ne suffisent plus.L’agilité est mieux adaptée : elle permet de tester et d’ajuster régulièrement les idées, favorise la collaboration et transforme le changement en opportunité plutôt qu’en problème. changements <> problèmes Première définition : L’agilité est une façon de gérer les projets qui mise sur l’adaptation rapide, le travail en équipe et l’amélioration continue, pour mieux répondre à un environnement